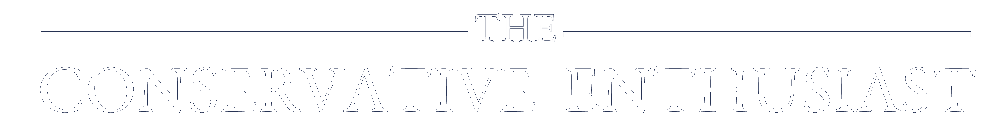Bienvenue sur cette série qui ajoute une rubrique toute inédite à notre catégorie Littérature et qui se nomme “La chronique de Grégory Roose“.
Cette rubrique, qui nous est proposé par Grégory Roose en personne, consiste à nous faire explorer des univers et des ambiances divers et variés, aux travers de nouvelles. Vous pouvez retrouver la rubrique à tout moment sur notre page Literature.
Vous pouvez également découvrir Grégory Roose et soutenir son travail grâce à sa tous les liens présents dans sa signature en bas de l’article.
Voici sa troisième micro-nouvelle :
La mangeuse d’hommes
La neige s’écrasait sur les flancs de la Valéia, étouffant les derniers témoignages d’un été verdoyant. Je marchais difficilement vers l’Église de Saint-Paul, luttant contre le souffle glacé du jour mourant. Elle tenait en respect les vieilles demeures en pierre qui protégeaient la place du village. L’architecture mortuaire du cimetière accolé à l’église m’attira. Elle était le vestige de temps révolus, de vies qui s’étaient croisées, aimées, méprisées pour finalement se confondre dans l’éternité.
Deux cents ans d’histoires intimes s’enchevêtraient sur les hauteurs de ce village de onze hameaux dominant le berceau de l’Ubaye. D’une certaine manière, il y avait davantage de vie dans ce sanctuaire que sur la place de l’Église.
On y devinait le quotidien révolu des cultivateurs cadencé par les éléments, celui des commis et des fonctionnaires rythmé par l’horloge de l’église, tandis que les grandes familles indigènes allaient et venaient entre les rivages de la Méditerranée et les hautes terres de leurs ancêtres. Je me frayais un chemin dans ce palimpseste macabre, chevauchant là une sépulture austère, gravissant ici un mausolée familial, oubliant quelques tombes au marbre impersonnel.
Quelques-unes m’interpellaient. On y voyait gravé le métier de ses occupants pendant leur passage terrestre : cultivateur, notaire, employé des PTT, greffier… et parfois la passion qui les avait occupés. La vue était imprenable. Peut-être la plus belle depuis cette partie du village désormais vidée de ses habitants : on en comptait neuf fois moins en 2021 que deux cents ans auparavant, ce qui donnait au cimetière des reflets de fête de village éternelle.
Une tombe se distinguait dans ce parterre de vies fauchées. Elle me sembla transcender toutes les autres par la banalité éprouvante de son histoire. Une simple croix de chêne surplombait la terre qui recouvrait le cadavre d’une époque, arraché à ses innombrables frères d’armes méthodiquement ensevelis, dans une rigueur toute militaire, sur les champs catalauniques du siècle des excès.
Un jeune homme gisait ici depuis plus d’un siècle, et je devins concerné, par le truchement d’une balade en famille, par la tragédie de son inexistence. Un cœur en email cloué sur la croix résumait ainsi sa vie :
Famille Émile Gras. Ici repose Émile Gras. Classe 1915. Blessé en Alsace. MORT POUR LA FRANCE le 16 janvier 1916. P.PL (priez pour lui)
Ainsi, cet homme était-il disparu à l’âge de vingt-et-un ans, sans doute dans l’enfer vosgien du Hartmannswillerkopf ? Je l’imaginais respirer l’air frais chargé de l’odeur des alpages, répondant soudain à l’appel des cloches qui sonnaient la mobilisation générale, en ce 1er août 1914. Je l’entendais nourrir la liesse virile d’une foule imberbe assurée d’écraser collectivement son ennemi.
Je l’observais dire « À bientôt » à des proches médusés qui lui rendaient un Adieu dépité. Au cœur de l’été 1914, le village de Saint-Paul-Sur-Ubaye participa à l’offrande collective de ses enfants, derniers témoins suicidaires d’une Europe hégémonique. Émile Gras, ce soldat inconnu, gisait sous mes pieds qui me commandaient de fléchir devant le symbole de son sacrifice imposé. Une rapide recherche sur mon smartphone exhumait les fantômes du passé. L’homme était petit, un mètre soixante-et-un.
Sa chevelure châtaine faisait ressortir un regard vert fendu d’un nez rectiligne sinueux. Il avait pour signe distinctif d’avoir les lobes des oreilles collés, selon sa fiche de renseignements militaire. Né Joseph Émile Auguste Gras, il choisit de ne pas être appelé par son premier prénom, comme c’était d’usage en ce temps-là. Le jeune cultivateur faisait sans doute pousser « un peu de tout » sur les rares replats glaciaires des hauteurs de Saint-Paul avant d’être affecté au 12e bataillon de chasseurs alpins à Embrun, dans les Hautes-Alpes, d’où il partira trois jours plus tard, le 4 août 1914, vers les Vosges.
Je levais les yeux vers le sommet de Bouchiers qui confortait ses apparats d’hiver. Cet Émile Gras l’avait peut-être conquis, du temps de sa candeur.
Peut-être songeait-il aux fraises des bois cueillies dans le vallon de la Blachière qui en regorgeait, aux ballades vers Fouillouse et les lacs de montagne alors que retentirent les premiers coups de feu meurtriers, le 22 août 1914, sur une route des Vosges, à Ingersheim, aux abords de Colmar. Émile Gras goûta aux horreurs de la Grande Guerre ce jour-là, subissant la perte de vingt-huit camarades, sans compter les nombreux blessés. Mes recherches confirmeront que cet Émile, dont la sépulture interrompit ma ballade, participa à la terrible bataille du Hartmannswillerkopf, ou du Vieil-Armand, du 19 janvier 1915 au 8 janvier 1916 sur une montagne des Vosges, dont la violence des combats et la rigueur du climat l’ont rendue aussi terrifiante que celles plus célèbres de la Marne, de Verdun ou de la Somme au point qu’on la surnomma « la mangeuse d’hommes ».
Il succomba à ses blessures, dans les derniers instants de cette terrible bataille, à l’hôpital temporaire des sources de Bussang où il fut inhumé avant que sa dépouille ne soit restituée à sa famille en 1920. C’est cette année-là qu’il reçut la Médaille militaire à titre posthume, comme un million quatre cent mille militaires français fauchés par ce conflit mondial.
Alors que je rangeais mon téléphone dans la poche de ma doudoune bleue, les yeux fixés sur les Alpes, je lançai un dernier regard sur la tombe du soldat Gras dont j’avais perturbé le long sommeil. Je l’avais fait revivre, l’espace de quelques instants, à travers l’intérêt que les vivants peuvent porter aux morts, parfois.
Il ne restait de son existence extraordinairement anodine qu’un carré de terre stérile surmonté d’une simple croix de bois. Puissent ces quelques lignes le faire revivre quelque temps à travers vous, cher lecteur, ainsi que ses millions de camarades tombés pour une France qui aujourd’hui se délite.

Si vous appréciez les articles de ce rédacteur et que vous souhaitez en découvrir davantage sur lui ou ses écrits, vous pouvez consulter tous ses articles ou le suivre sur ses différents réseaux sociaux ci-dessous.